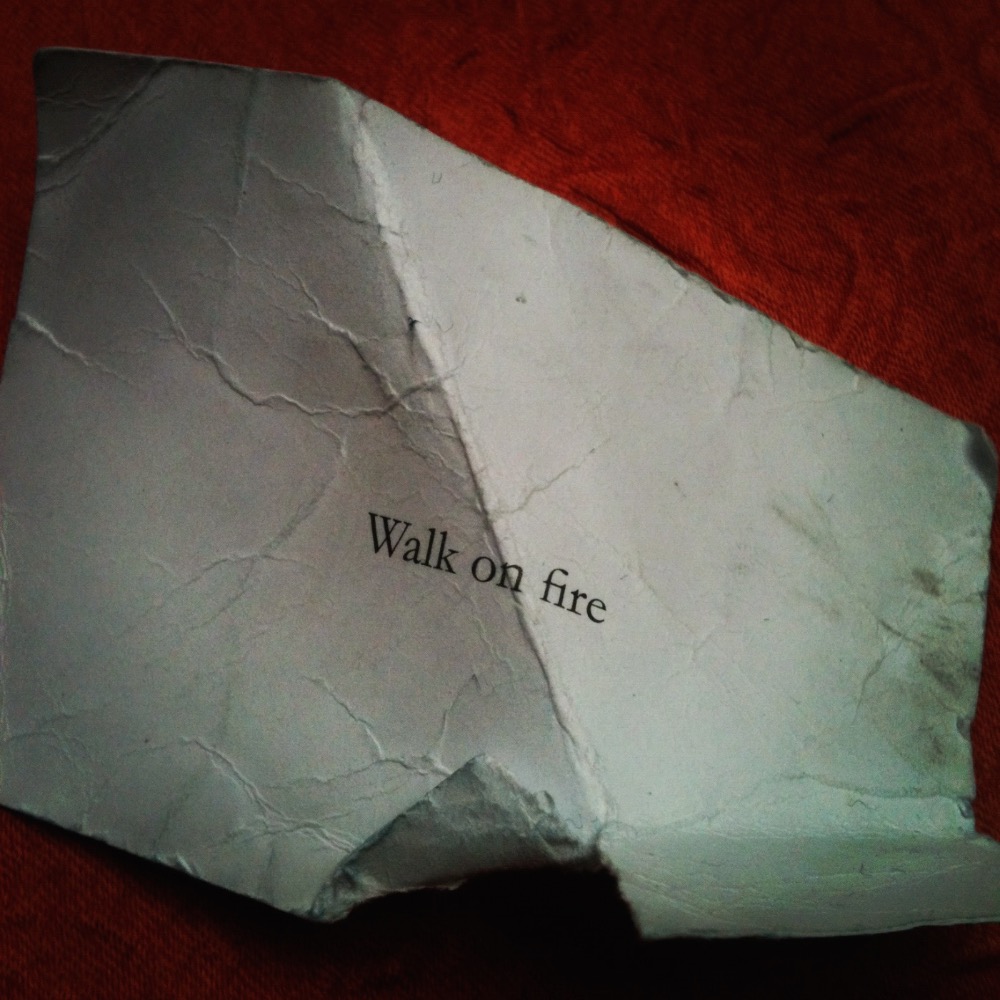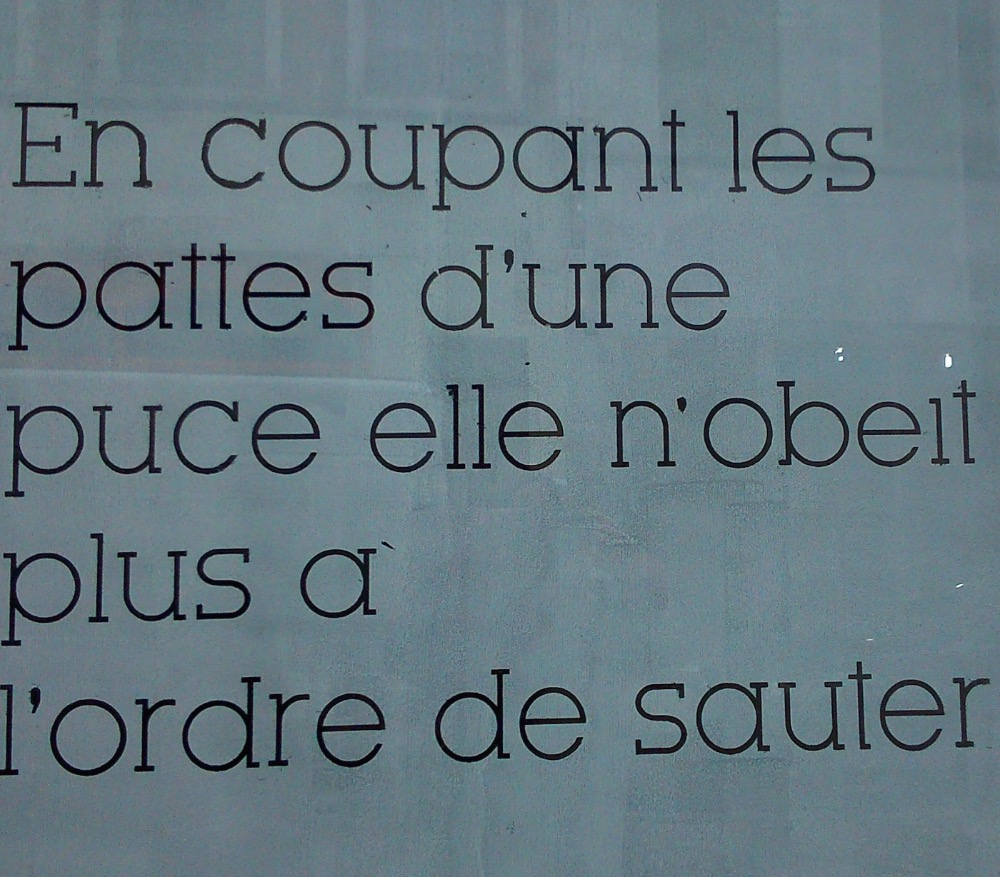[NOUVEAUTÉ] Les longs silences, de Cécile Portier 4 novembre 2015 – Publié dans : Notre actualité – Mots-clés : Cécile Portier, les longs silences, pierre ménard
Plaisir d'annoncer la parution d'un texte fort de Cécile Portier : Les longs silences, et puisque Pierre Ménard en a été le collaborateur éditorial, laissons-lui la parole.
—
Entre eux il y a de longs silences.
(Je dis eux pour ne pas dire nous.)
*
* *
En février 2014, à la suite d’un burn out, Cécile Portier entre pour trois semaines en clinique psychiatrique. Pendant ce temps de soins, elle éprouve le besoin de noter les sensations qui la traversent, d’écrire ce lieu et ceux qu’elle y rencontre. Elle enregistre par l’écriture le flux des conversations, des sons, de ses propres pensées (« La pensée est-elle un organe ? Avoir mal en pensant, est-ce mal penser, est-ce une maladie ? »). Elle note le déroulement des heures et des gestes, le « temps qui passe en spirale, en entrelacs, en rond, en n’importe quelle forme qui ne soit ni droite ni orientée », les journées qui se répètent inexorablement, « des horaires pour tout : l’heure des repas, l’heure des médicaments, l’heure des activités, l’heure de fermeture du salon commun. Il y a des horaires pour tout qui font qu’on sait facilement sur quoi bute notre attente ». Les activités, les ateliers dessin, presse, et l’heure du goûter. « De nos vies nous ne voyons que les mécanismes. »
« Dans le petit bureau vitré, l’infirmière fait un jeu sur l’ordinateur. Il n’y a pas toujours quelque chose à faire quand on travaille pour aider les gens à trouver du repos. » Un peu après, à l’occasion d’une partie de Scrabble avec deux autres patients : « Je pense à ce mot, l’internement. L’interne ment. Pas le jeune homme en blouse blanche et à la voix péremptoire, qui fait des remplacements. L’interne de soi-même, son propre intérieur, se met parfois à mentir. »
Le burn-out s’impose comme un symbole de notre époque. Il est rare, dans l’histoire, qu’un trouble psychique nouveau se popularise aussi vite, au point que chacun en saisisse les enjeux ravageurs. Inventé par l’écrivain anglais Graham Greene dans son roman A Burnt-Out Case, paru en 1961, ce syndrome, qui touche des millions de travailleurs, est identifié par le philosophe Pascal Chabot dans Global burn-out comme une vraie « maladie de civilisation », telles la mélancolie au XIXe siècle, la paranoïa et la schizophrénie au XXe. Exténué, vidé, incapable de se détendre et de récupérer, l’individu qui sombre dans le burn-out a le visage de la grande fatigue contemporaine. Les sujets qui craquent, rappelle le philosophe, sont le plus souvent des travailleurs enthousiastes, des « soutiens zélés des modes de vie contemporains ».
« La question devient : qui a sa place dans ce monde du travail ? »
Grâce à leur ardeur au travail, le système se perpétue et produit en même temps les conditions d’une vulnérabilité généralisée. Ces gens cassés subissent ce que nous connaissons tous : « La montée en puissance du régime de production, l’accélération des cadences, l’intensification du stress, la généralisation des instruments de contrôle, la dureté des contraintes. » Cette « maladie de civilisation » est surtout une « maladie de la relation ».
Le sentiment d’étrangeté du lieu, le sentiment, même, d’en être étrangère, font place au constat que cette intimité non choisie est un partage. « Sur la terrasse on fume. Dans le salon on reste assis, on attend l’heure des repas. On reste assis si on a réussi à s’asseoir. » La description de l’endroit (sa terrasse, son jardin, le salon, les chambres), nous montre l’envers de ces « lieux de fatigue ».
« Il y a un jardin. Il n’y a presque jamais personne au jardin. Rosiers aux branches nues, acanthes qu’on dirait cirées tellement elles luisent, primevères, lierre sur les murs sombres. Et des lauriers. Beaucoup trop de lauriers. »
Loin d’être un isolement, ce moment vécu est celui d’une confrontation réconciliante avec l’altérité, en premier lieu la sienne propre. « Avant d’entrer ici on passe par le service des admissions. C’est sûr que d’entrer ici, c’est difficile à admettre. » L’occasion de tenter de comprendre avec pudeur la raison de sa présence, de saisir tout ce qui lui échappe, qui transparait dans les moindres faits du quotidien : « Ça toque pour apporter le petit déjeuner. Ça toque pour apporter les médicaments. Ça toque pour laver le lavabo, les sanitaires, le sol, ça toque pour la consultation, ça retoque pour prendre la tension, et ainsi de suite, ça toque. » Cécile Portier remarque qu’en entrant elle doit « déposer ses médicaments, si on en avait avant d’en arriver là ». Elle note alors toute l’ironie de cette demande. « En arriver là, et pourquoi ? c’est la question que tout le monde voudrait se poser, c’est la question presque impossible. »
L’auteur dresse également le portrait de tous ceux qui l’accompagnent dans cette traversée silencieuse, cette réclusion à l’internement. Les liens se tissent progressivement entre ceux qui se côtoient sans se connaître vraiment, entre qui « s’instaure une politesse très particulière, comme retenue et pudique, et qui est autre chose qu’un ensemble de règles de bienséance. C’est plutôt comme une reconnaissance, le constat de partager quelque chose ». Une longue liste de figures dessinées en creux, qui s’insère au fil du texte comme des apparitions, portraits fragiles rendus vivants, sensibles, par le rythme même de cette énumération, parce que c’est la première construction de langage permettant d’élaborer et de déplacer le regard. Documentation d’un univers, d’un entourage, jusqu’alors inconnu, qu’on prend en note pour ne pas l’oublier. S’oublier.
« Celui qui dit : on a chacun notre histoire.
Celle qui dit : dehors c’est la guerre.
Celle qui a toujours le même bandeau motif panthère sur ses cheveux lissés, et des yeux bleus et ronds comme jamais revenus d’un étonnement très ancien.
Celle qui ne dit rien mais hoche la tête continûment comme un petit pendule, pour ponctuer la conversation.
Celui qui a la lèvre inférieure indéfiniment pendante et le regard creux, celui qui donne l’impression que plus rien ne lui parle et l’atteint, celui-là participe, articule une pensée, insiste et précise, délicat dans ses approches. »
Elle n’a, à première vue, rien en commun avec ceux-là qui sont ici en même temps qu’elle, mais le seul fait d’avoir été défaillants les rapproche. Elle comprend que cette défaillance n’est pas que personnelle, qu’elle est l’écho, le symptôme peut-être, d’un fait social. « Dans ma chambre du pavillon, le lino est troué par endroits. Tout le monde a le droit d’avoir des failles. » Elle déjoue tous les poncifs du témoignage ou du récit d’expérience, avec une distance désarmante, dans sa capacité à saisir le détail qui fait sens, qui remet en cause les évidences, pointe les faux-semblants, et d’un trait vif, direct, précis, dénonce les mécanismes de notre quotidien.
« Les mécanismes ont besoin d’être réglés. Charlot resserre les boulons, resserre les boulons, resserre les boulons. Et une fois qu’il a fini, ressert les mêmes gestes, ressert les mêmes gestes, ressert les mêmes gestes. Le mécanisme est entré en lui. Le mécanisme c’est lui. Rien ne résiste aux mécanismes.
Les mécanismes ont besoin d’énergie. Les mécanismes ont faim. Si on ne les nourrit pas ils s’arrêtent tout seuls. Buster Keaton fait feu de tout le bois du train pour alimenter sa locomotive, il désosse les banquettes, sacrifie le plancher des wagons. Il continue et avance très vite mais au prix de tout dévaster. »
Ce texte nous touche en nous laissant une impression douce-amère. « Apparemment personne ici ne se tape la tête contre les murs. » Son langage révèle les failles de nos existences sans les accentuer en les dénonçant trop vite, mettant des mots d’une rare justesse, d’une précision saisissante sur ce qui n’en trouvait plus d’efficients depuis longtemps, déficience passagère surmontée en nommant avec précision ce qui l’entoure comme si c’était la première fois, avec une candeur qui vise au cœur, un œil neuf qui permet d’interroger ce qu’on ne voyait plus ou qu’on ne voulait plus voir.
Cécile Portier est une auteur occupée par le monde et sa transcription. Elle a publié plusieurs ouvrages (notamment Contact et Saphir Antalgos, travaux de terrassement du rêve, édités chez publie.net) et réalisé différents projets sur blogue, mêlant texte et photographie, tels que À mains nues où elle a demandé pendant six mois à des passagers du métro de parler de leurs mains, pour ensuite les photographier et rendre compte de ces rencontres par écrit. Plus récemment elle a mis en ligne Étant donnée, un projet collectif de fiction poétique transmédia mené à partir d’une interrogation poétique sur nos traces numériques, qui prend la forme d’un projet artistique hybride où des textes et d’autres propositions graphiques ou sonores se répondent.
En écrivant ainsi, elle voit ce que le numérique change à ses propres pratiques, comment il fait déborder son écriture vers d’autres formes que celles qu’elle imaginait initialement, elle a ainsi de plus en plus souvent recours à l’image et au son dans ses projets de création, non pas comme illustration de son travail, mais comme point de départ, instance de dialogue) : Le numérique, selon elle, n’est pas qu’un support ou un outil, mais un champ nouveau dans lequel nous sommes tous plongés, qui – pour autant – est encore à investir, à questionner.
Les longs silences fera l’objet d’une performance multimédia, et prolonge à sa manière cette recherche et cette expérience. « Écrire ici c’est repasser toujours par les mêmes points, oublier l’exigence d’avancer vers quelque part. » Cécile Portier enregistre au plus ras de ce qui se passe, du temps qui ne passe pas. Et toujours, ce refus de se laisser enfermer, jusque dans ce qu’on attend d’elle.
Préface de Pierre Ménard
SE PROCURER LE LIVRE (EN PAPIER ET NUMÉRIQUE)
LIRE UN EXTRAIT AU FORMAT EPUB
À noter que deux livres du catalogue entrent en résonance avec le livre de Cécile Portier : Le garde-fou, de Tiphaine Touzeil, et Refuge sacré, de Cathie Barreau.