Carnet de bord 2021, semaine 7 21 février 2021 – Publié dans : Notre actualité – Mots-clés : jacques ancet, Laurent Grisel, Philippe de Jonckheere, Pierre Guyotat
publie.net, le feuilleton (que le monde du livre nous envie) à retrouver chaque semaine, par GV.
lundi
Astuce : s'arranger inconsciemment pour faire figurer par erreur deux fois la même tâche dans sa tasklist, de préférence la première à effectuer le lundi, de manière à commencer la semaine en ayant le sentiment (fictif mais néanmoins plaisant) d'avancer deux fois plus vite. C'est ce que j'ai fait ce matin. Ensuite, j'ai ouvert un article du Figaro (ça arrive). Il y est question des maisons d'édition à l'ère de la pandémie permanente, et de leur survie dans le tumulte de cette époque atonale (ça a l'air d'être un oxymore, mais c'est bien la réalité). L'article n'est pas mauvais en lui-même mais il part d'un postulat étrange, un de ces raccourcis journalistiques dont on se demande un peu comment ils font pour ne pas voir l'éléphant dans le magasin de porcelaine : On disait le secteur en crise. Pourtant en France paraissent deux cents livres par jour, édités par sept mille maisons différentes. N'est-ce pas précisément le contraire ? Le secteur n'est-il pas en crise parce que paraissent deux cents livres par jours ? Enfin, pour ce que j'en sais. Le reste de l'article dresse un portrait assez juste de la situation actuelle et tout le monde s'y retrouvera : de l'éditeur backé par Flammarion et Gallimard qui publie Jean Teulé dans sa première année et manie assez bien le langage néo-managérial pour parler de label plutôt que de maison d'édition ou de collection, à la petite structure artisanale où une seule personne fait tout en passant par le milieu de gamme de l'édition qui se force à trouver des points positifs en 2020 sur le mode le numérique ne nous a pas tués, eh eh. Je caricature. Mais pas tant que ça. Ce qui retient mon attention, c'est une formule à la fin : À l'autre bout du spectre, les plus petits doivent s'armer d'une foi inébranlable. Les plus petits, ça doit être (entre autres) eh bien nous. Je ne sais pas si on bénéficie d'une foi inébranlable, et si c'est le cas je sais que ce n'est pas une arme. Mais il y a une leçon à tirer de cette formule toute faite : le spectre, ici, n'est pas du ressort du prisme chromatique, c'est bel et bien le fantôme. Celui du père d'Hamlet, par exemple, lui apparaissant au début de la pièce pour lui apprendre qu'il a été assassiné. Dans cette métaphore, le père d'Hamlet n'est pas le livre, dont on nous a rebattu les oreilles ces quinze ou vingt dernières années qu'il était voué à disparaître, assassiné toujours par le numérique, jamais par la hausse des loyers en centre-ville et la grande-distribution. Non, le spectre c'est celui de la littérature, absente au juste de quelle part des deux cents livres qui en sont à paraître chaque jour et dont tout le monde feint de ne pas remarquer qu'elle a été, sinon assassinée, du moins sérieusement évincée de la chaîne.
mardi
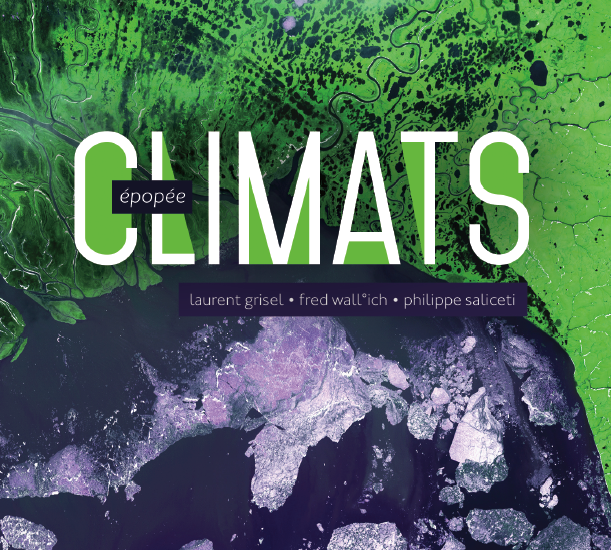
C'est jour de bouclage pour le disque de Climats, avec dépôt des fichiers chez l'imprim, euh, chez les gens qui font les disques. Ce qui consiste grosso modo à revérifier compulsivement les fichiers et les visuels dans la hantise qu'on aurait laissé passer un truc (air connu). L'autre air connu qui va et vient, c'est celui (dans la presse comme chez les lecteurs en librairie, on en parle justement avec Julie) de ceux qui se lassent de voir des livres qui ne sont pas des romans, ou pas de la fiction, dans les magazines, à la radio, et donc sur les tables des libraires. C'est amusant parce que je relis justement les épreuves des Voix du temps de Jacques Ancet cette semaine et je tombe précisément ce matin sur ce passage (en réalité je ne tombe pas, l'ayant déjà relu plusieurs fois, mais enfin disons que le hasard fait bien les choses) :
(...) la prétention du naturalisme à reproduire la réalité n’est qu’une illusion. Toute réalité n’est, en effet, que la rencontre du désordre des phénomènes et d’un esprit qui les organise. Saisir la réalité au plus près — puisque telle est aussi leur ambition — ce sera donc abandonner l’absurde prétention objective, laquelle veut ignorer que le langage est une abstraction, incapable de nous donner les choses, pour — dira Dujardin, l’inventeur du monologue intérieur avec Les Lauriers sont coupés, en 1883 — «se plonger dans les profondeurs de l’âme.» Ces jeunes écrivains — Huysmans, Gide, Barrès, Loti, de Gourmont, etc. — ne vont cesser de battre en brèche le patron du roman de l’époque au nom d’un impérieux désir de faire coïncider la littérature et la vie. Si Barrès peut affirmer que «la réalité varie avec chacun de nous, puisqu’elle est l’ensemble de nos habitudes de voir de sentir et de raisonner », Jules Renard écrit dans son Journal : «Il y a les conteurs et les écrivains. On conte ce qu’on veut ; on n’écrit que soi-même.» Et il conclut : «La formule nouvelle du roman, c’est de ne pas écrire de roman.» Ce qu’Alain-Fournier illustre par ces lignes suggestives : «Avec Laforgue il n’y a plus de personnage du tout c’est-à-dire qu’on s’en fiche absolument. Il est la fois l’auteur et le personnage et le lecteur de son livre. Le personnage s’embarque-t-il un soir d’août : ah ! les crépuscules des petits ponts en été; hein ! les hirondelles qui filent, les chiens qui aboient à la soupe sur unepéniche amarrée. Allons en voilà assez: le personnage est à présent au soleil, au printemps : ah ! ces matinées comme on n’en trouve plus avec des abeilles dans les herbes, etc. Évidemment, ça c’est plus vrai que tout, plus profond que tout. Il n’y a pas de supercherie, il n’y a plus de petite histoire. Ça n’est pas du roman, c’est autre chose.»
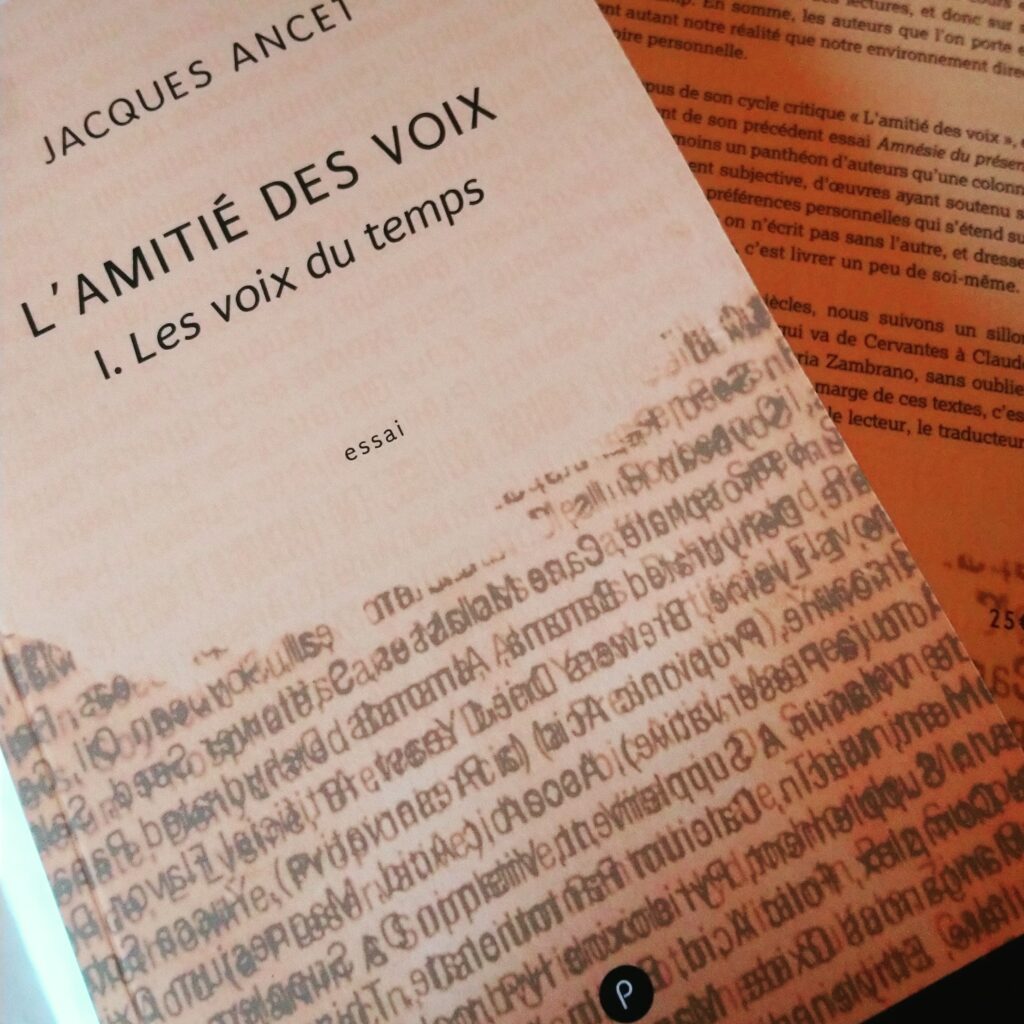 mercredi
mercredi
Il y a peu quelqu'un me disait ne pas comprendre pourquoi les éditeurs actuels, et pas forcément dans les grands groupes, se focalisaient autant sur la communication. L'important, n'est-ce pas les textes eux-mêmes ? J'ai mis ça de côté et puis ça m'est revenu : en faisant le listing des choses que nous pouvions faire pour sortir de l'orniè, euh des sentiers battus, me voilà confronté à cette interrogation. C'est qu'en réalité, la communication est peut-être le seul domaine sur lequel nous avons une capacité d'action directe. On sait bien combien il est difficile, voire impossible, d'aller à contre-courant des acteurs de la chaîne du livre : soit on va dans le même sens que tout le monde (diffusion, distribution, circuits des attachés de presse et autres relais), et on ne maîtrise rien, n'étant nous qu'un maillon parmi d'autres, soit on fait notre truc dans notre coin et on est peu suivi puisqu'on est seul (been there, done that). On sait aussi qu'on ne peut pas réellement influer sur les textes eux-mêmes, sinon choisir d'être actifs dans notre recherche d'auteurs avec qui travailler, et tâcher de les accompagner au mieux une fois venu le stade des réécritures. Ne reste donc que la communication au sens large : quel objet pour le livre, quelle identité graphique, que mettre en valeur en quatrième, comment présenter le livre à d'autres, quel matériel de communication presse et libraires, qui cibler et comment, comment toucher tout ce beau monde, etc. D'où peut-être dans la profession une certaine forme de surinvestissement dans cette voie, sachant que c'est le seul espace de liberté qui reste. Mais le mot même est un symptôme de quelque chose et on l'entend souvent. Il faut qu'on communique. Ou alors Mon éditeur n'a pas assez communiqué. Mais qu'entend-on précisément par communiquer ? Qu'est-ce que cela recouvre ? Et jusqu'où ça va ? J'ouvre un podcast sur les machineries du monde du livre : pour être visible, il faut de la PLV. Je referme le podcast. Parfois on a le sentiment que communiquer, c'est une autre façon de dire il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi ? Mais il faut déjà mettre ces interrogations de côté : j'ouvre un mail pour communiquer en interne et qui dit il y a un problème. Il va donc falloir se creuser la tête pour le résoudre.
jeudi
Dans ce fort bel article de Chloé Martin via Actualitté sur les pratiques numériques en matière de poésie paru cette semaine, on a une drôle d'impression. Celle que la poésie en numérique (et au-delà la poésie tout court) ça vaut pas le coût. Littéralement, pas le coût de production du fichier. Je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est pénible. Pénible à lire chez d'autres comme, parfois, à penser soi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Peut-être que ça veut dire qu'on ne le fait pas pour le même public que le public traditionnel du marché du livre. Guyotat disait, en substance, que sa littérature n'était pas de la littérature mais de l'art : elle sera de la littérature dans cinquante ans. En sommes, on n'écrit pas pour le strict moment de la publication, on écrit pour les lecteurs du siècle à venir. Impossible de faire coïncider ce temps long avec le feu de paille éditorial habituel, celui sur lequel se focalise toute la chaîne du livre en permanence : l'actualité stricte, le tempo des quelques semaines de présence en librairie (six, cinq, quatre qui sait, ça ne va pas en s'arrangeant). Le hiatus entre les conditions de création, de production, de diffusion et (pardon pour ce gros mot) de consommation de la littérature n'est donc pas en voie d'être résolu. D'ailleurs, quand on prend l'un des livres de Pierre Guyotat, qui comportent souvent des textes en préambule (préfaces, avertissements ou autres), on tombe sur cette note de l'éditeur qui ouvre le volume et qui dit : Le vrai problème que ce texte à proprement parler inqualifiable pose jusqu'au malaise est celui de sa lecture. C'est littéralement la première phrase du livre. C'est bien curieux à lire. Et une drôle de façon de communiquer pour le coup. C'est à se demander s'il n'aurait pas été plus pertinent d'écrire les mêmes recommandations que Thelonious Monk adressait aux musiciens pour jouer sa musique et relayées l'autre jour par Philippe De Jonckheere sur Twitter :
Don't play the PIANO PART, I'm playing that, don't listen to me, I'm supposed to be accompaning YOU ! https://t.co/xXCr41V29g
— Philippe De Jonckheere (@DesordreNet) February 16, 2021
Ne lisez pas tout (ou tout le temps). Laissez filer. Certaines phrases sont à imaginer. Etc. Il m'est arrivé de le dire ou de l'écrire ailleurs, mais ma rencontre avec Guyotat (avec son œuvre, pas rien avec lui-même) a changé ma vie. Je ne parle même pas de ma lecture du livre mais de ma rencontre avec la possibilité de son existence. Je me souviens de tout : de où, de quand, de quel livre, de quel rayonnage dans quelle librairie, de quel geste, du conseil que m'a alors fait la libraire et de comment j'en suis venu à l'ignorer et à n'en faire qu'à ma tête. J'ai bien fait. Sauf qu'avec le numérique, il y a un problème. On ne peut pas se dire : les projets innovants que l'on fait, ils ne sont pas pour maintenant, ils sont pour dans cinquante ans. Indépendamment de notre prospérité future, qui sait ce que deviendront nos epubs, nos sites, nos expériences étranges, je ne dis même pas dans cinquante ans mais ne serait-ce que dans trois, cinq, dix ans ? Un objet numérique, ce n'est pas un tome intemporel, c'est un monde lu par un autre. Un fichier est interprété par la machine qui le décode et lui permet d'accéder à une forme de représentation. On voit déjà qu'à l'instant t nos epubs ne sont pas interprétés de la même manière par tel ou tel appareil (de même que nos sites web ne sont pas rendus pareils selon les navigateurs). Alors dans cinquante ans ? C'est sans doute à la fois un problème et une solution : ces livres, ces textes, ces projets, il faudra nécessairement les reproduire, voire les reconstruire, voire les recomposer si on veut les faire perdurer. Si ça se trouve, il faudra même les réécrire, ce qui peut paraître un cauchemar absolu, j'imagine, pour un auteur (ou alors, c'est le contraire, et c'est le comble de l'excitation). Peut-être même qu'il faudra les confier à d'autres pour les traduire sous d'autres formes et dans d'autres formats. Mais il y a une chose dont je suis sûr en revanche : les livres qu'on publie, expérimentaux ou non, innovants ou pas, ils sont de nature à changer la vie de quelqu'un, quelque part. Peut-être ou non qu'ils y parviennent. Peut-être ou non qu'ils sont accueillis ou reconnus comme tel. Mais les conditions de leur rencontre avec le public ne sont pas solubles dans un délai de quatre à six semaines. Et aucun livre dont la profondeur de champ (pour ne pas dire la durée de vie) est d'un tel laps ne sera en mesure de changer quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Et alors que fait-on contre ça ? On communique, comme ici ?
vendredi

J'ai déjà dû l'écrire ici ou là mais l'impression des timbres ici suit une certaine logique animalière. Les rhinocéros (500g) sont plus lourds que les pandas (250g) qui sont plus lourds que les lapins (100g) qui jouent dans une autre catégorie que les hiboux, dévolus eux aux timbres internationaux (car ils volent de nuit sans doute). Ça me permet de dégainer plus rapidement mes timbres lors des préparations d'envoi pour gagner de précieuses secondes (non : c'est nécessairement ludique et un brin compulsif). Mais là, c'est la catastrophe philatéliste. De hiboux sur le site de la Poste, point. Où sont les hiboux ? Est-ce une façon de me faire comprendre qu'en temps covidés et virusés on n'envoie rien à l'autre bout du monde ? Est-ce un complot contre ma personne ? Est-ce une odieuse discrimination des petits éditeurs indés dans le vaste marché de l'expédition de marchandises (ou de documents si on veut passer la douane plus sereinement) ? Est-ce tout simplement une erreur de serveurs sur lesquels les visuels sont stockés ou une sombre histoire de droits des dessins noir et blanc de hiboux ? Anticipe-t-on sur l'extinction des hiboux en coupant court à leurs effigies de papier ? Si j'opte finalement pour le dessin du renard, y a-t-il un message caché dans ce choix iconographique (surveillez vos poules !) ? En plus, c'est un renard un peu glaçant, qui n'a pas d'yeux dans le regard, aux formes bien géométriques, et qui pourtant te regarde de face comme s'il allait fondre sur toi. Mais qui, toi ? L'expéditeur ou le destinataire ? Le facteur ou le personnel du centre de tri ? Les machines (dont il faut dire par ailleurs qu'elles ne laissent plus passer les enveloppes de plus de 3cm de haut pour te forcer à payer un Colissimo pendant qu'Amazon négocie des tarifs anti-concurrentiels pour ses propres envois) ? Le problème quand on est habitué à vouloir chercher du sens partout (dans les moindres mots de chaque phrase de nos textes, dans les éléments graphiques des couvertures de nos livres, dans les paroles de tout un chacun sur les splendeurs et misères de la chaîne du livre), comme on le fait dans ces carnets, c'est que fatalement, à force, on en trouve. Et partout.
